Jeunes Chinois en quête d’harmonie : le grand paradoxe des trois sagesses
Sur une estampe ancienne, on imagine un maître taoïste assis au bord d’un torrent de montagne. Ses yeux sont mi-clos, son souffle s’accorde au chant de l’eau, et rien ne semble troubler la paix de son visage. L’harmonie est là, discrète, comme un battement lent du monde.
À quelques centaines de kilomètres de cette montagne, dans une chambre étudiante à peine éclairée, un jeune homme s’est entouré de piles de livres qui montent comme des murailles. Ses yeux rougis ne quittent pas les pages. Demain, après-demain, ou dans quelques mois, il jouera peut-être sa vie au Gaokao, l’examen national qui décidera de son avenir. Entre ces deux images — le sage en paix et l’étudiant épuisé — se dessine un contraste presque douloureux.
La Chine est le berceau de trois sagesses millénaires qui toutes, à leur manière, célèbrent l’équilibre, le détachement et la juste mesure. Le taoïsme parle du souffle qui s’écoule comme l’eau, le bouddhisme offre un refuge intérieur face à la souffrance, et le confucianisme trace la voie de l’accomplissement moral et de la responsabilité envers autrui. En théorie, ces sagesses devraient former une armure invisible contre l’anxiété et l’agitation.
Pourtant, c’est une autre réalité qui s’impose aujourd’hui : la jeunesse chinoise ploie sous le poids d’une compétition acharnée, entre examens implacables, marché du travail saturé et attentes familiales immenses. Dans un pays qui porte au cœur de son héritage la promesse de l’harmonie, comment expliquer que l’anxiété soit devenue l’une des marques de la jeunesse ?
C’est ce paradoxe, à la fois culturel et profondément humain, que nous allons explorer.

Le confucianisme : du perfectionnement de soi à l’impératif écrasant de réussite
Au commencement, l’étude n’était pas une arme de compétition, mais un chemin d’élévation.
Dans les paroles de Confucius, on trouve l’idée que chaque être humain peut devenir un jūnzǐ (君子), un « homme de valeur » : quelqu’un qui cultive sa vertu, affine son jugement et met son savoir au service de la société. L’éducation (jiàoyù, 教育) n’était pas seulement une question de notes, mais un exercice moral, presque spirituel.
Dans les vieilles ruelles encore habitées de Qufu, la ville natale de Confucius, on peut voir des écoliers réciter d’une voix claire des classiques vieux de deux mille ans. Ils le font avec application, comme d’autres enfants jouent à la marelle. Ce geste répété, cette fidélité au texte, n’est pas simplement une préparation scolaire : c’est une façon d’entrer dans une lignée, de participer à une tradition qui fait de l’étude un art de vivre.
Dans cet idéal, apprendre, c’était se rapprocher de l’harmonie. Mais au fil des siècles, ce lien entre savoir et vertu s’est entremêlé à un autre pilier du confucianisme : la piété filiale (xiào, 孝).
Respecter ses parents, prendre soin d’eux, perpétuer leur mémoire : autant de devoirs qui façonnent la vie quotidienne des Chinois depuis des générations. Mais dans la Chine moderne, ce respect ancestral a pris une forme nouvelle et redoutable : réussir ses études est devenu le premier moyen de « rembourser » la dette envers sa famille.
Dans les campagnes, il n’est pas rare de voir des parents vendre leurs terres ou s’endetter pour payer des cours privés de leur enfant unique. Dans les villes, des grands-parents veillent tard dans la cuisine pour préparer des raviolis chauds à leur petit-fils qui révise jusque dans la nuit. Chacun, silencieusement, investit dans la réussite de cet enfant. Comment, dès lors, supporter l’idée de l’échec ?
Là où Confucius voyait un chemin vers la vertu, la société contemporaine a fabriqué une mécanique de compétition. L’étudiant ne se bat pas seulement pour lui-même, mais pour toute une lignée. Échouer, c’est trahir la confiance d’une famille entière, c’est briser l’avenir que plusieurs générations ont placé entre ses mains. Le poids psychologique devient colossal, une charge invisible mais constante.
Et au sommet de cette logique se dresse le Gaokao (高考), l’examen national d’entrée à l’université, véritable muraille moderne où se jouent les destins
Le Gaokao, une épreuve qui décide d’une vie
Chaque mois de juin, la Chine entière semble retenir son souffle. Dans les grandes villes comme dans les petites bourgades, les mêmes scènes se répètent : des files de jeunes en uniforme scolaire, sacs à dos serrés contre eux, s’avancent vers l’entrée de leur centre d’examen. Les rues autour des écoles sont fermées à la circulation, les klaxons interdits, et les habitants sont priés de réduire le bruit. Même le ciel paraît plus lourd ce matin-là.
Le Gaokao dure deux à trois jours et décide, en grande partie, du destin d’un adolescent. Quelques heures d’épreuves condensent des années d’efforts, de nuits écourtées, de cahiers noircis. Derrière les grilles, des parents attendent en silence, certains serrant des bouteilles d’eau dans leurs mains comme des talismans, d’autres murmurant des prières. Une mère raconte qu’elle n’a pas dormi depuis deux nuits, comme si son propre avenir se jouait derrière ces murs.
Le Gaokao n’est pas qu’un examen. Il est une ligne de partage. Pour beaucoup, un bon score ouvre la porte des universités prestigieuses comme Tsinghua ou Pékin, synonymes de carrière prometteuse et d’ascension sociale. Un mauvais résultat, au contraire, peut condamner à des études secondaires ou à un emploi précaire, et donc, souvent, à la déception familiale.
En Occident, on compare parfois le Gaokao au baccalauréat, mais la comparaison est trompeuse. Ici, la pression est d’une intensité que peu d’étrangers peuvent imaginer. Dans certaines régions rurales, où les ressources sont rares, un seul enfant réussissant au Gaokao peut transformer le destin de toute une famille. Pour ces jeunes, chaque page tournée est chargée d’un poids collectif.
Sous le regard de Confucius, l’étude était une quête intérieure. Sous celui du Gaokao, elle est devenue une bataille nationale, où des millions de jeunes s’affrontent dans une compétition implacable.

Taoïsme et bouddhisme : des sagesses consolatrices mais marginalisées dans la course au succès
Dans les pages du Dao De Jing, Lao Tseu évoque le wúwéi (无为), ce « non-agir » qui ne signifie pas l’inaction, mais le fait d’agir en accord avec le flux naturel des choses. Comme l’eau qui trouve toujours son chemin, même face aux rochers. L’image est belle, fluide, apaisante.
Mais pour un étudiant enfermé dans sa chambre à réviser quinze heures par jour, ces mots sonnent comme une utopie lointaine. Comment « suivre le courant » quand tout, dans la société, pousse à nager à contre-courant des autres pour ne pas être noyé ?
On dit parfois que le taoïsme est la philosophie des montagnes et des ermites, de ceux qui ont déjà conquis leur place et peuvent se permettre le luxe de la lenteur. Dans la Chine moderne, il reste souvent en arrière-plan, comme un rêve inaccessible pour une jeunesse condamnée à la vitesse. Les jeunes le redécouvrent parfois après leurs études, lors d’un voyage, ou bien à la retraite de leurs parents. Mais dans le temps brûlant de la jeunesse, il demeure un murmure étouffé.
Le bouddhisme, lui, enseigne que la vie est souffrance (dukkha) et que l’attachement aux désirs mondains en est la source. À première vue, cette philosophie pourrait être un remède à l’anxiété. Mais pour la majorité des jeunes Chinois, le bouddhisme n’est pas une voie structurante : c’est une consolation individuelle, un refuge discret.
Dans les temples, il n’est pas rare de voir des étudiants venir brûler de l’encens avant le Gaokao, ou déposer des offrandes de fruits avant un entretien d’embauche. Ils ne cherchent pas à « s’éveiller » au sens bouddhiste du terme, mais à trouver un peu de réconfort, une protection symbolique.
Une étudiante de Pékin raconte qu’elle glisse chaque matin un petit bracelet de perles bouddhistes autour de son poignet avant de se rendre à ses cours. « Ça ne change rien à mes examens, dit-elle en souriant, mais ça me donne l’impression de respirer un peu. » Ce geste minuscule dit tout : le bouddhisme n’est pas une solution au système, mais une béquille fragile pour survivre à la pression.
Ainsi, dans la hiérarchie implicite de la Chine contemporaine, le confucianisme domine la jeunesse — il exige la réussite et trace la voie à suivre. Taoïsme et bouddhisme, eux, attendent à la lisière : des sagesses pour plus tard, ou des remèdes temporaires aux blessures causées par la compétition.
Le choc avec les réalités modernes : quand la démographie et l’économie écrasent l’héritage philosophique
Chaque été, ce sont près de dix millions de lycéens qui se présentent au Gaokao. Derrière ces chiffres, il y a des salles bondées, des pupitres serrés, des mains qui tremblent en noircissant des copies. La Chine est vaste, mais ses meilleures universités — Pékin, Tsinghua, Fudan — comptent des places limitées. La lutte est donc féroce, presque darwinienne.
Dans certaines provinces rurales, un seul étudiant admis dans une université d’élite devient l’orgueil de tout un village. Sa réussite fait la fierté des anciens, sa photo est affichée dans la rue, comme une médaille collective. Mais pour un qui réussit, combien de rêves s’effondrent en silence ? Dans l’ombre de ces chiffres se cachent des milliers de destins contrariés.
Il fut un temps où un diplôme suffisait à ouvrir la voie vers un avenir stable. Mais dans la Chine d’aujourd’hui, cette promesse s’est effritée. La croissance économique a ralenti, tandis que le nombre de diplômés a explosé. Résultat : un marché saturé où même les titulaires d’un master ou d’un doctorat peinent à trouver leur place. L’incertitude ne disparaît pas après les études, elle change seulement de visage.
À cette anxiété s’ajoute la logique impitoyable du monde du travail. Dans les grandes villes, la « rat race » prend une forme singulièrement chinoise, résumée par un nombre devenu symbole : le 996. Travailler de 9 heures à 21 heures, six jours par semaine. Si cette culture d’entreprise a été officiellement condamné par les autorités et recule dans les grandes entreprises sous les projecteurs, il persiste sous une forme plus insidieuse : le « volontariat forcé » (强制自愿, qiángzhì zìyuàn). La charge de travail est souvent calibrée pour être impossible à terminer en 8 heures, et une pression sociale implicite pousse à rester tard sous peine d’être perçu comme « peu motivé ». La quête d’équilibre se heurte ainsi à une culture du présentéisme toujours vivace, où l’heure de départ devient un indicateur de loyauté.
Ainsi, l’anxiété ne s’arrête pas avec le diplôme. Elle continue, sous une autre forme : la peur de ne pas se démarquer, la crainte d’être remplacé, la fatigue d’une course sans fin. Dans cette logique, l’équilibre tant vanté par les sagesses anciennes paraît lointain, presque irréel.
À cela s’ajoute une donnée démographique unique : la politique de l’enfant unique, en vigueur durant plus de trois décennies. Elle a a concentré sur un fils ou une fille les attentes de deux parents et de quatre grands-parents. Derrière l’image du « petit empereur », souvent caricaturée, se cache une réalité plus lourde : celle d’un héritier chargé de toutes les espérances.
Chaque victoire scolaire est célébrée comme un triomphe collectif. Chaque échec, au contraire, devient une blessure familiale. « Tu n’étudies pas seulement pour toi », répètent certains parents, « mais pour nous tous. » Cette phrase, souvent prononcée avec tendresse, contient pourtant un fardeau immense : réussir n’est pas une option, c’est une obligation.
La pression est d’autant plus forte que dans un pays où les systèmes de retraite restent fragiles. Les fonctionnaires et employés du public bénéficient de pensions relativement confortables. Les salariés du secteur urbain privé perçoivent une retraite de base, souvent suffisante pour couvrir les dépenses essentielles. Mais les agriculteurs et les travailleurs migrants, eux, sont les plus vulnérables : leur retraite se limite à quelques centaines de yuans par mois, soit quelques dizaines d’euros, totalement insuffisants pour survivre.
Dans ce contexte, « compter sur ses enfants » (kào háizi, 靠孩子) n’est pas seulement une valeur culturelle héritée de la piété filiale, mais une nécessité économique. On attend d’eux qu’ils décrochent un emploi sûr, qu’ils assurent un revenu stable, qu’ils s’occupent de leurs parents et de leurs grands-parents vieillissants. L’amour filial se confond avec une dette impossible à solder.
Les jeunes adultes sont pris dans une double pression :
Vers le haut : ils doivent aider financièrement leurs parents, surtout si ceux-ci viennent du monde rural ou ont eu des carrières modestes ;
Vers le bas : ils doivent investir massivement dans l’éducation de leur propre enfant, afin que ce dernier réussisse et devienne, à son tour, leur futur soutien.
Cette « génération sandwich » (三明治一代, sānmíngzhì yīdài) vit avec la certitude que tout repose sur elle.
Un jeune diplômé de Shanghai résume ce sentiment d’étau : « J’ai l’impression de marcher avec six vies sur mes épaules. Si je tombe, tout le monde tombe avec moi. »
Dans cette logique, comment imaginer l’esprit de légèreté prôné par le taoïsme, ou le détachement du bouddhisme ? Chaque pas de ces jeunes est déjà alourdi par l’héritage invisible de leur famille.
Vers une nouvelle quête d’équilibre ?

Face à cette pression constante — des études jusqu’au travail, de la famille jusqu’à la société —, certains jeunes finissent par dire non. Un non discret, mais lourd de sens.
En 2021, un mot a commencé à circuler sur les réseaux sociaux chinois : tǎng píng (躺平), littéralement « s’allonger ». Derrière cette expression se cache un choix volontaire : renoncer à la compétition acharnée, refuser de courir dans la roue sans fin des diplômes et des heures de bureau. « Si je m’allonge, dit un étudiant de Canton, je ne tombe pas. » C’est une forme de résistance passive, une manière de reprendre son souffle en refusant le rythme imposé.
Le bǎi làn (摆烂) est peut-être la réponse la plus radicale à ce paradoxe. C’est un rejet résigné mais compréhensible de la piété filiale confucéenne détournée. Puisqu’il est impossible de réussir assez pour honorer sa famille, autant « laisser pourrir » la situation et, symboliquement, l’impératif de réussite lui-même. C’est une harmonie trouvée dans l’effondrement des attentes, une forme de paix amère qui serait incompréhensible pour le sage taoïste de l’estampe.
Mais toutes les réponses ne passent pas par le retrait. Certains jeunes cherchent à reconstruire autrement leur rapport au monde. On les voit quitter les grandes métropoles pour retourner à la campagne, cultiver un petit potager, ou travailler à distance depuis une maison bon marché dans une ville secondaire. D’autres choisissent de ralentir volontairement, de privilégier le temps avec leurs proches, ou d’explorer les sagesses spirituelles que leurs aînés avaient reléguées en arrière-plan.
Ces mouvements restent minoritaires, mais ils disent quelque chose d’essentiel : la quête d’harmonie, mise à mal par la compétition et la pression sociale, n’a pas disparu. Elle réapparaît sous d’autres formes, plus fragiles, plus hésitantes, mais profondément humaines. Comme si, au milieu du vacarme, un souffle ancien cherchait à se faire entendre à nouveau.
Alors que le gouvernement tente de réformer le système de retraite et de réguler le monde du travail, une lente prise de conscience émerge. La quête d’harmonie ne se fait plus dans la contemplation sereine d’un maître, mais dans les choix fragiles de toute une génération qui tente de redéfinir, à contre-courant, ce que signifie « une vie réussie ». Leur équilibre, s’il advient, ne sera sans doute pas celui des anciennes sagesses, mais un hybride fragile, fait de résistance silencieuse et de réinvention quotidienne.
Christophe Durandeau

Découvrir les ouvrages de Christophe






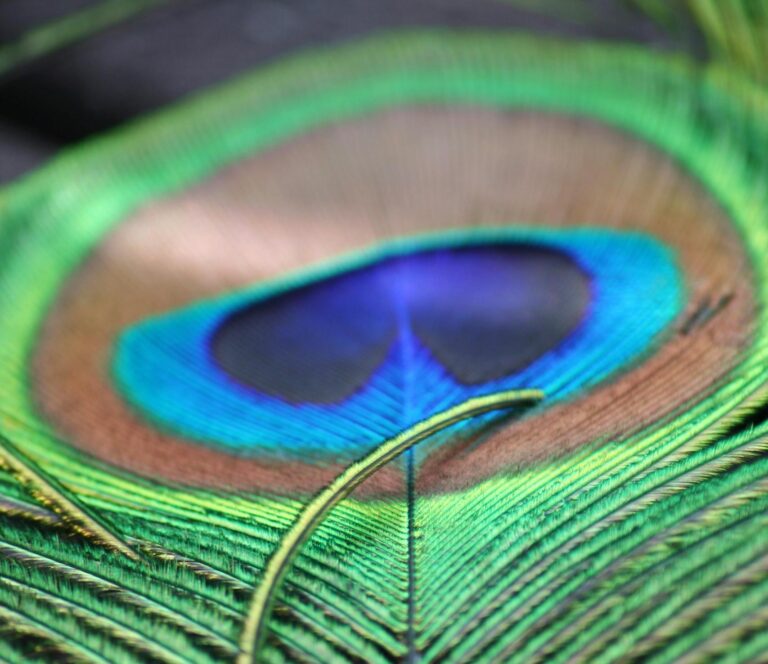

Larticle met en lumière la pression immense du Gaokao sur les jeunes Chinois, liée à la culture confucéenne et aux réalités modernes. Cest une analyse profonde et touchante de notre époque.
Compétition et pression sociale. Réussir dans le système mi-capitaliste, mi-communiste. La pression des nouvelles technologies de l’information et de la communication… Tout ceci ne peut assurer l’harmonie dans une nation démographiquement sous tension.